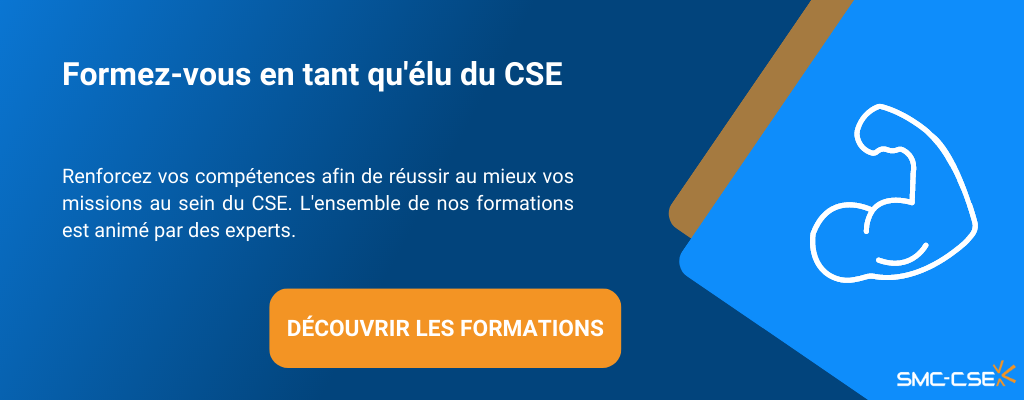L’intelligence artificielle est désormais déployée au sein de secteurs d’activités et de métiers variés.
Par exemple, dans l’industrie (pour la détection de pannes ou d’erreurs dans la fabrication de certains produits ou l’optimisation des temps production), dans la banque et l’assurance (pour le traitement automatisé des dossiers d’octroi de crédit et d’indemnisation des sinistres), dans la logistique, l’énergie, la grande distribution (pour la planification automatisée des commandes et livraisons et le suivi en temps réel).
Si les bénéfices attendus de l’IA s’inscrivent dans une logique de rationalisation et de réduction des coûts en temps de travail et en effectifs nécessaires pour réaliser les tâches, son introduction génère de nombreux risques.
Quels sont les principaux impacts de l’IA ? Quels sont les risques psychosociaux concernés ? Quels sont les moyens d’action du CSE ?
Faisons le point :
Sommaire
1. Quels sont les principaux impacts de l’IA ?
Les impacts majeurs concernent :
- La sécurité des données : fuites de données, données corrompues, etc.
- L’éthique en lien avec le traitement des données notamment le risque de discrimination du fait d’un algorithme biaisé, la création de fausses informations ou le détournement de données à caractère personnel
- L’environnement : avec l’utilisation de ressources informatiques importantes sans visibilité sur l’impact environnemental de celles-ci.
La mise en place de projets en lien avec l’intelligence artificielle entraine aussi d’importants bouleversements dans l’organisation du travail et des conditions de travail.
Ces évolutions sont notamment susceptibles de porter sur les différents aspects du travail :
- Les missions et les tâches à effectuer
- Les compétences à mobiliser
- L’autonomie au travail
- Le rythme du travail et la charge de travail
- Les relations hiérarchiques
- Le contrôle de l’activité
- L’équilibre vie privée/vie professionnelle
- L’évolution des métiers
2. Quels sont les principaux risques psychosociaux concernés ?
Si les changements induits par l’introduction de l’intelligence artificielle exposent les salariés à de nombreux risques professionnels, ce sont les risques psychosociaux qui sont tout particulièrement concernés.
Par exemple, un projet d’intelligence artificielle entrainant une réduction des délais de livraison ou d’intervention chez un client se traduit très souvent par une augmentation des objectifs et par conséquent une intensification du travail.
La mise en place d’un projet d’IA peut aussi impacter l’aspect collectif de travail en réduisant les possibilités de soutien que ce soit au sein d’une équipe ou de la part du management.
Des effets de contrôle peuvent aussi survenir donnant aux managers la possibilité de savoir à quelle heure les salariés se connectent. Ils peuvent suivre le travail effectué à travers la réalisation d’un document en temps réel, ou encore savoir en temps réel où sont localisés les salariés lorsqu’ils sont en tournée.
Certains projets peuvent également modifier les tâches à accomplir par les salariés ce qui peut générer une perte d’intérêt et de sens du travail, les salariés n’ayant plus une vision globale d’un dossier par exemple.
Enfin, l’installation de projets en lien avec l’intelligence artificielle génère des incertitudes sur l’avenir en termes de craintes sur la pérennité de certains métiers.
Autrement dit, les systèmes d’intelligence artificielle ont un impact sur l’activité de travail, son organisation générant des risques psychosociaux tels que stress, tensions, conflits et portant ainsi atteinte à la santé mentale des salariés.
3. Quels sont les moyens d’actions du CSE ?
- Information-consultation obligatoire :
Aux termes du L.2312-8 du code du travail, un employeur doit réaliser une information-consultation du CSE
- En cas d’introduction de nouvelles technologies, ce qui est le cas avec l’intelligence artificielle
- Ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
Dans le cadre de la mise en place d’un projet d’IA, les employeurs doivent fournir en amont toutes les informations nécessaires afin que les membres élus du CSE puissent rendre un avis éclairé.
Concrètement, ils doivent présenter au comité :
- Le projet : contenu, calendrier, objectifs
- Ses impacts sur les conditions de travail à travers notamment l’organisation actuelle et projetée, l’évaluation de la charge de travail actuelle et projetée, les modifications générées par le projet sur l’activité de travail, l’évaluation des risques professionnels notamment les risques
- Ainsi que les mesures d’accompagnement aux changements prévus.
Remarque :
Il est constaté dans certaines entreprises que des projets d’IA ont déjà été mis en œuvre sans information-consultation. Des phases « pilotes » sont ainsi déployées se traduisant par une période d’expérimentation lors de laquelle l’outil est mis en place au sein d’une équipe ou d’un site par exemple avant un déploiement généralisé. Or, le fait que le déploiement soit partiel n’exonère par les employeurs de leur obligation de respecter le processus d’information-consultation des CSE sur le déploiement de l’IA en amont de sa mise en œuvre.
Le Tribunal judicaire de Nanterre, par ordonnance du 14 février 2025, l’a d’ailleurs rappelé obligeant une entreprise à suspendre le déploiement des différents outils d’IA, même en phase « pilote », tant que le processus d’information-consultation n’était pas achevé.
- Possibilité pour les CSE de recourir à un expert technique
Dans le cadre de l’information-consultation réalisée en amont de l’instauration de projets d’IA, les CSE peuvent faire appel à un expert technique, visé à l’article L.23.15-94 du code du travail, qui intervient à l’occasion :
- De projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
- De l’introduction de nouvelles technologies
Sa nomination doit intervenir dès la première réunion d’information de la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet.
Sa mission consiste à analyser le projet afin de comprendre les enjeux en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, les changements organisationnels présentés par l’employeur et d’identifier les risques professionnels pouvant être générés par le projet.
Il est chargé d’établir un diagnostic et des recommandations afin de prévenir ou réduire les risques professionnels identifiés.
Il permet ainsi aux élus du CSE de disposer d’éléments d’analyse leur permettant de rendre un avis éclairé et de le motiver.
L’expertise est financée à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement.